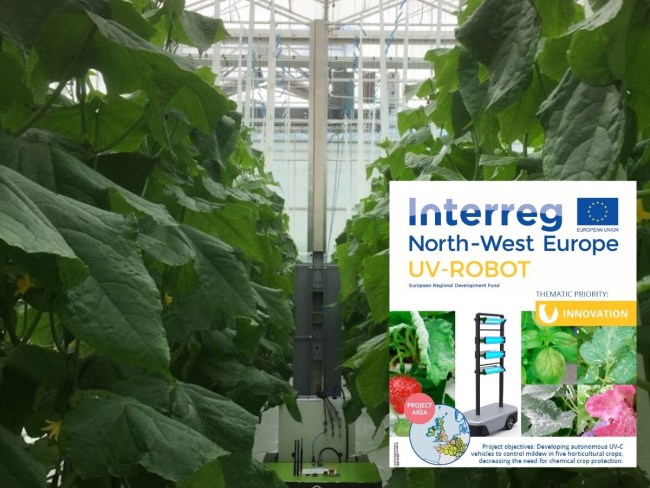Evaluation de solutions de lutte contre : l’hoplocampe, le puceron mauve et la cécidomyie des poires
Description du projet
Dans le cadre de ce projet, le choix a été fait de se focaliser sur trois ravageurs du poirier particulièrement problématiques en AB : le puceron mauve, l’hoplocampe du poirier et la cécidomyie des poirettes. Pour chacun de ces trois ravageurs, il s’agit de proposer et d’évaluer des stratégies ou solutions de lutte en phase avec le cahier des charges AB. L’évaluation technique comporte bien évidemment une dimension efficacité et positionnement mais intègre également des préoccupations relatives au maintien de la faune auxiliaire. La durée du projet (3 ans) ainsi que son implantation sur trois bassins de production distincts (Val de Loire, PACA, Alpes) sont la garantie d’une évaluation robuste et fiable.
Malgré sa réputation d’espèce “rustique”, la poire est, à l’image de la pomme, exposée à un large panel de bioagresseurs. L’augmentation des surfaces conduites en bio associée au manque, voire à l’absence de solutions de lutte efficaces, créent un contexte qui favorise les résurgences de ravageurs dits secondaires (jusque-là maîtrisés à l’aide des insecticides à large spectre utilisables en conventionnel). À l’image du virus de la granulose pour le carpocapse, les solutions de lutte développées en arboriculture biologique sont de plus souvent plus sélectives, ce qui permet le développement de ravageurs non ciblés. C’est notamment le cas de l’hoplocampe du poirier (Hoplocampa brevis) et de la cécidomyie des poirettes (Contarinia pyrivora). Ces deux ravageurs peuvent localement impacter très lourdement la récolte (plusieurs dizaines de %). Les fruits atteints finissent par tomber au sol où ces insectes effectuent une partie de leur cycle. La population est donc inféodée au verger et a tendance à augmenter si rien n’est fait pour la maîtriser. Or, en AB, aucune substance n’est actuellement homologuée pour ces usages. C’est également le cas pour le puceron mauve (Dysaphis pyri). Celui-ci peut, de par sa virulence, causer des dégâts sur la récolte de l’année mais aussi sur celle de l’année suivante et affaiblir l’arbre, mettant en danger la productivité du verger. Cette inquiétude est confirmée par les dernières campagnes qui, quel que soit le bassin de production, ont été marquées par une recrudescence de ce ravageur dans les vergers.
Résultats
Pour lutter contre le puceron mauve en verger biologique, un essai de défoliation précoce à l’automne a été mis en place dans un but de perturber le cycle de ce ravageur et de limiter ainsi sa présence au printemps suivant. L’application de chélate de cuivre a permis de hâter la chute des feuilles et le seuil de 50% de feuilles chutées a été atteint mi-octobre. Le suivi du vol montre que le vol a débuté fin septembre et s’est terminé fin novembre. La défoliation est donc intervenue au début de cette période de vol. Ce qui, au regard des résultats obtenus lors de la notation du nombre de foyers au printemps suivant, semble avoir eu un impact sur la population de pucerons mauves avec une pression réduite d’environ 75% dans la modalité défoliée.
Le programme d’essais conduit sur la cécidomyie des poirettes cherche à assurer un suivi biologique afin de mieux comprendre son cycle et notamment l’occurrence de son émergence, et à évaluer différentes solutions de lutte. La durée de la période de vol des cécidomyies est d’environ 2 semaines avec un pic de vol à identifier par observation visuelle. L’utilisation de phéromones développées par l’Université de Greenwich a permis d’améliorer significativement l’efficacité du piégeage et de mieux suivre la dynamique de vol. Lors de la deuxième année, malgré une forte pression avec un nombre d’individus piégés très élevé (plusieurs milliers), la solution d’une alternative de lutte par piégeage massif ne semble pas concluante. En effet, le pourcentage de dégâts est inchangé en comparaison d’une modalité sans piégeage. Parmi les solutions de lutte testées, la mise en place de filets mono-rang anti-drosophiles avant les premières émergences, même si elle est contraignante, semble être la plus probante. Les résultats montrent une réduction de plus de 70% des dégâts sur fruits. Les données collectées lors des 5 années d’essai ont par ailleurs permis de calculer une somme de degrés jours entre le 1er janvier et le pic de vol de 475 ± 15°C afin de mieux anticiper l’installation de ces filets.
Quant au vol de l’hoplocampe du poirier, il s’étale sur une période de 2 semaines, juste avant la floraison des poiriers. Le suivi des populations a confirmé l’efficacité et la fiabilité des pièges blancs englués. Néanmoins, les conditions météorologiques, avec notamment le gel de début avril 2022 n’a pas permis de mener l’essai lutte jusqu’à son terme et les solutions testées n’ont donc pas pu être évaluées.