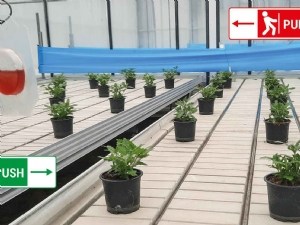Risque perçu et comportements d'achat
En 2022 et 2023, le CTIFL a étudié l'impact du conseil et du service sur les achats de produits à faible demande, voir l'article Effet du conseil et du service par un vendeur sur les achats de fruits et légumes frais, publié dans le N° 402 d'INFOS CTIFL [1]. La présence de vendeurs influence significativement la décision d'achat et encourage les consommateurs à acheter de nouveaux produits. Cependant, pour le melon, la présence du vendeur n'a pas influencé les ventes. Les non-acheteurs considèrent le prix, l'aspect et la difficulté pour choisir le produit comme des freins à l'achat. Une enquête, réalisée par le CTIFL en 2020 auprès d'un échantillon de 944 acheteurs de melons charentais, révèle que près de la totalité des consommateurs de melons (92 %) seraient disposés à en acheter davantage s'ils étaient assurés de leur qualité au moment de l'achat. Les critères de sélection du melon ne sont pas toujours bien maîtrisés, ce qui donne l'impression que choisir un melon relève parfois de la « loterie » [2].
L'être humain est réticent à prendre des risques [3] : choisir des produits familiers offre un sentiment de sécurité et de confiance [4, 5, 6, 7], mais choisir un produit dont la qualité n'est pas observable représente un risque. Les consommateurs peuvent éprouver un sentiment de perte - perte financière, perte de satisfaction et perte du produit s'il ne correspond pas aux attentes et n'est pas consommé - lorsque la qualité du produit ne correspond pas à leurs attentes initiales. Pour atténuer l'aversion des consommateurs aux pertes, les entreprises peuvent partager des informations pour réduire leur incertitude quant à la qualité des produits et la perte psychologique qui pourrait en résulter. La présence d'un vendeur en rayon est également une solution potentielle. La compétence des vendeurs ressentie par les consommateurs les rassure, diminuant ainsi l'incertitude et le risque perçu lors de l'achat.