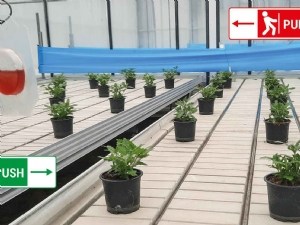La myrtille
Myrtille sauvage versus myrtille cultivée
La myrtille est de plus en plus prisée tant pour ses qualités gustatives que pour ses bienfaits sur la santé. Consommée sous différentes formes (fraîche, cuite, séchée, en jus, etc.), elle séduit un nombre croissant de consommateurs. La myrtille appartient à la famille des Éricacées. L'espèce sauvage européenne Vaccinium myrtillus se distingue des variétés cultivées nord-américaines Vaccinium corymbosum. La myrtille sauvage est un arbrisseau rampant de 20 à 60 cm, tandis que les variétés cultivées peuvent atteindre jusqu'à 2 m de hauteur. La floraison intervient au printemps, avec de petites fleurs en forme de cloche, généralement blanches ou rosées. La fructification a lieu en été, entre juin et septembre selon les variétés et les régions. Le fruit est recouvert de pruine, lui donnant un aspect légèrement poudré. Sa culture nécessite un sol acide (pH entre 4 et 5,5), bien drainé et riche en matière organique ainsi qu'une exposition ensoleillée. Sensible à la sécheresse, elle demande une irrigation maîtrisée. Très rustique, elle supporte bien le froid hivernal, mais les gelées tardives peuvent endommager les fleurs.
Le marché de la myrtille
Un marché mondial en pleine croissance
Le marché mondial de la myrtille est en forte expansion. Avec environ 296 000 tonnes produites (voir l'article Le marché des petits fruits rouges poursuit sa croissance p. 15), les États-Unis sont de très gros producteurs, suivis du Canada qui domine la production de myrtilles sauvages (160 000 t). Depuis les années 2010, l'Amérique latine a pris une place croissante avec le Pérou (290 000 t), le Chili (100 000 t) et le Mexique (70 000 t), qui offrent une production contre-saisonnière par rapport à l'hémisphère nord. Le Maroc (60 000 t) s'impose également sur le marché, tandis que la Pologne, l'Espagne et le Portugal sont les principaux producteurs en Europe.